Vers une éthique du pilotage
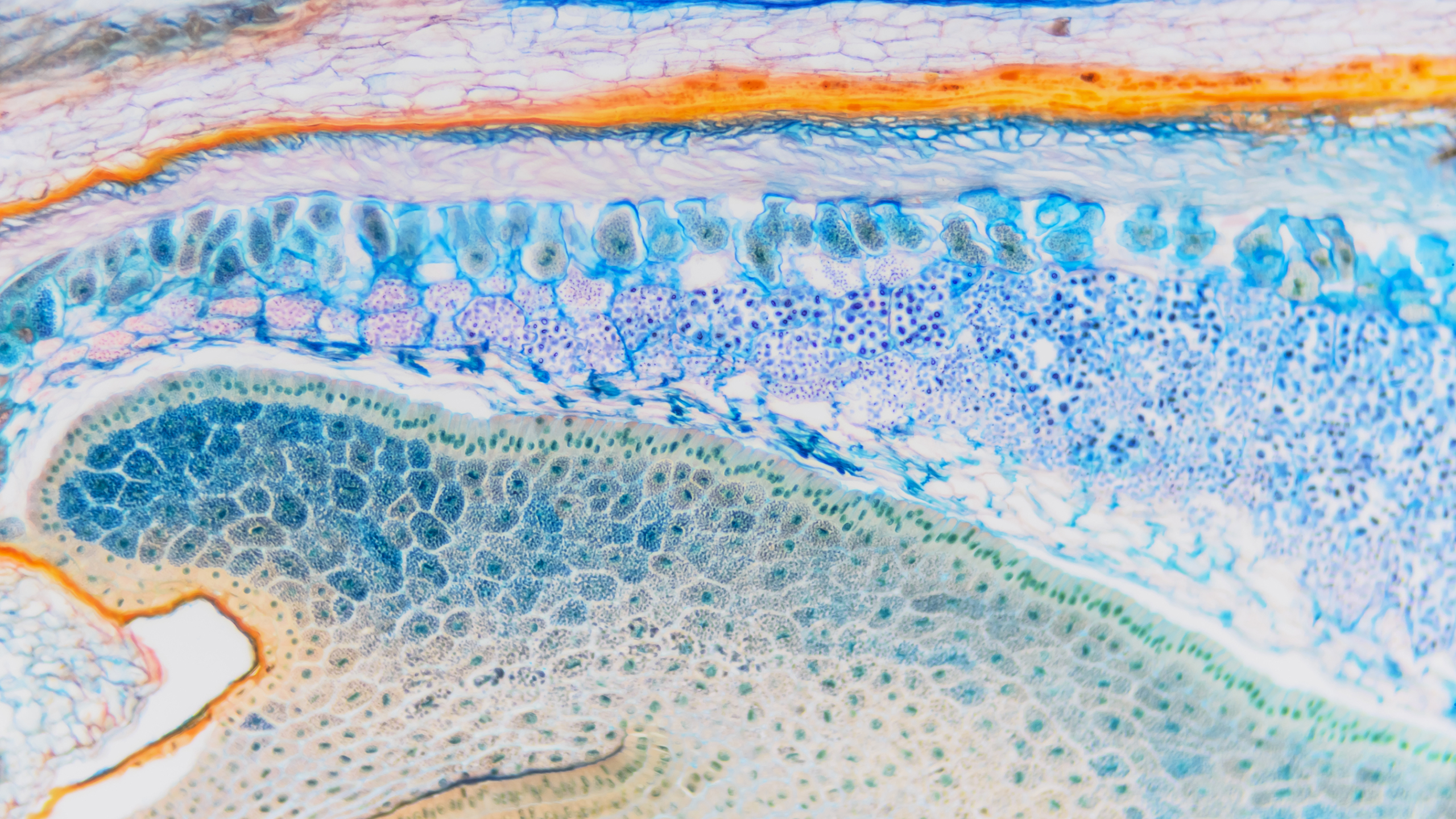
- Publié le 18 novembre 2017
- Catherine Larrère
La place prise par l’homme dans l’évolution de la planète pose d’urgentes questions d’éthique et de responsabilité. Au travers de leur travail de philosophie environnementale, Catherine et Raphaël Larrère remettent en cause dans la notion d’Anthropocène comme époque géologique, qui relève d’une fascination pour la puissance humaine. Plus symbolique que scientifique, la notion est d’abord le support de récits antagonistes, entre quête de davantage de manipulation ou vision catastrophiste de l’effondrement. En opposition au sentiment de maîtrise, ils développent une réflexion autour des grands paradigmes de la technique, prônant une exploration des possibles par le « pilotage », une démarche du « faire avec » consistant à initier, utiliser et orienter des processus naturels. Il s’agit d’avoir l’humilité du pilote et de l’éleveur plutôt que l’arrogance de l’ingénieur et du fabricant. Saisir la nature non comme substance, extérieure à l’homme, mais de façon relationnelle, leur permet de développer une éthique du soin de ce qui n’est pas nous sans relever de l’extériorité radicale.
L’Anthropocène : une invention symptomatique de l’anthropocentrisme ?
Pour faire le lien avec le troisième numéro de la revue Stream, paru il y a deux ans, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous remettez en cause la définition de l’Anthropocène comme « époque géologique » et ce que représente ce terme pour vous ?
CL : Anthropocène est un terme paradoxal. Donner le nom des humains à une époque géologique – puisque ánthrôpos signifie « homme » en grec ancien – ce n’est pas seulement dire qu’une nouvelle époque vient de succéder à la précédente, c’est innover dans la façon de la qualifier. Les noms des époques faisaient auparavant référence à des indications temporelles ou pédo-géologiques. Holocène signifie « entièrement récente », le Jurassique fait allusion à la chaîne du Jura et le Carbonifère à la présence de charbon par exemple. L’entrée dans l’Anthropocène signifierait deux choses : des changements suffisamment importants pour que l’on puisse parler d’une nouvelle époque sont observables, et ce sont les hommes qui en sont responsables. Mais en choisissant de dire cette époque humaine, on court deux risques : faire comme s’il n’y avait plus que de l’humain, comme si l’humain avait absorbé la nature, et comme si c’était quelque chose dont on pouvait se glorifier. Le terme d’Anthropocène a été très critiqué et d’autres appellations ont été proposées – Capitalocène ou Technocène, par exemple. Mais du point de vue de la disparition de la nature, cela revient au même : parler de « Technocène », c’est dire que la terre est de part en part transformée par la technique. L’appellation « Gaïa » pose au contraire que la Terre peut continuer à exister – et continuera à exister sans les hommes. C’est pourquoi, sans doute, même si l’appellation d’Anthropocène a été proposée par des scientifiques (Stoermer, un géologue et Crutzen, un chimiste), elle a surtout plu aux sciences humaines. C’est une façon, non seulement de caractériser notre temps – celui des humains –, mais en plus de présenter cela comme un récit, le nouveau grand récit, celui de l’Anthropocène.
Nombreux sont ceux qui ont déploré la fin des grands récits (la Nation, le Peuple) de la modernité à l’époque post-moderne. En revoilà donc un, et celui-ci est global, il vaut pour la Terre entière. Mais c’est très ambigu. Porté par l’anthropocentrisme du mot, on peut y voir celui de l’achèvement de la conquête de la Terre, dont l’homme est vraiment devenu maître et possesseur. C’est la version du « bon Anthropocène », un récit optimiste de la poursuite du Progrès, grâce au pouvoir que les humains ont de manipuler la Terre au niveau global. C’est sur fond de ce récit optimiste qu’est proposée la géo-ingénierie La géo-ingénierie préconise la modification de la composition des océans ou de l’atmosphère par injection de dérivés soufrés ou de sulfate de fer par exemple, pour limiter l’effet de serre ou favoriser le développement d’algues planctoniques réputées pour piéger le carbone..
À l’inverse de celui-ci, est la version catastrophiste, qui constate aussi la puissance humaine, mais pour s’en effrayer : l’Anthropocène est l’époque qui procède de la modernité (Progrès, maîtrise de la nature) au moment où celle-ci conduit à sa destruction : la puissance que l’homme a imposée se retourne contre lui. Nous entrons dans une période d’effondrement jalonnée de brusques ruptures catastrophiques. Entre ces deux façons extrêmes d’être fasciné par la puissance humaine, il faut étudier la diversité des modes de vie, pas nécessairement catastrophistes, permettant de vivre dans l’Anthropocène, cette époque qui porte les stigmates de l’action humaine et où prolifèrent les hybrides d’humains et de nature.
RL : Quant à la datation de l’entrée dans l’époque Anthropocène, il y a plusieurs hypothèses. La plus commune la fait commencer par la révolution industrielle, qui marque le début de la libération massive dans l’atmosphère du carbone piégé dans le charbon (puis le pétrole). Une seconde la fait remonter à l’apparition de l’agriculture, ce qui signifierait que l’Holocène n’a jamais existé, puisqu’il commence à peu près à la même époque. Une autre hypothèse, enfin, attribuerait son origine à la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. L’arrivée des Européens sur le continent, suivie de la propagation d’épidémies et du massacre des Amérindiens ayant décimé jusqu’à 90 % de la population locale, ont profondément affecté la façon dont les Indiens maintenaient par l’usage du feu les grandes prairies du nord ouvertes au pâturage des bisons. En Amérique Centrale et du Sud, l’agriculture sur défriche ou brûlis a été abandonnée à grande échelle. À défaut d’entretien, ces espaces sont devenus des friches, puis des forêts, augmentant le nombre d’arbres comme autant de pièges à carbone. Les carottes de glace révèlent en effet une baisse non négligeable du taux de carbone de l’atmosphère à cette époque – ce qui correspond d’ailleurs au petit âge glaciaire, puisque le C02 est un gaz à effet de serre. Dès cette époque, l’action de l’homme a donc eu un impact repérable sur le climat. Cette hypothèse est très discutée, puisque beaucoup de commentateurs définissent l’Anthropocène comme une époque marquée par une modification non réversible du système Terre. Or, dans ce cas précis, bien que l’impact humain ait été repérable, le phénomène a été totalement réversible en ce qui concerne le climat. Il a suffi aux colons de déboiser pour rétablir la composition atmosphérique et le climat. L’impact le plus durable aura été celui sur la biodiversité : les échanges entre le nouveau monde et l’ancien ont permis aux espèces de voyager, d’où un brassage de plantes, d’animaux et de germes pathogènes recréant en quelque sorte la PangéeContinent unique s’étant morcelé au Trias, il y a 250 millions d’années..
Ce récit est-il le symptôme d’une nouvelle crise identitaire, en raison du repositionnement de l’homme dans la nature et de notre position paradoxale, tout à la fois de victime et de bourreau ?
CL : C’est là que réside la grande ambiguïté de l’Anthropocène. On a l’habitude de dire que le développement des sciences a remis en cause le narcissisme spontané des hommes, notamment autour de trois blessures narcissiques relatives à de grands décentrements : avec les découvertes de Copernic et de Newton, la Terre n’est plus au centre de l’univers et le système solaire n’est qu’un système parmi d’autres ; avec Darwin, l’homme n’a plus été créé à l’image de Dieu, il a co-évolué avec l’ensemble du vivant ; avec Freud, enfin, l’homme n’est plus, selon l’expression cartésienne, « le capitaine de son navire », puisque son inconscient lui échappe.
RL : Selon Dominique Lestel, il y aurait même une quatrième blessure narcissique, plaçant l’Anthropocène au cinquième rang. Celle-ci serait marquée par l’apprentissage de la langue des signes à une femelle chimpanzé, éclipsant le langage des caractéristiques proprement humaines.
CL : La dernière serait relative à la prise de conscience de notre impact négatif sur notre propre milieu et, a fortiori, de notre propre mise en péril. La profonde équivocité de l’Anthropocène réside dans le fait que, contrairement aux premières blessures narcissiques – résultant de découvertes décentrant l’homme –, celle-ci le remet au centre. L’Anthropocène relève plus de la science-fiction que de la science en ce sens que l’apport scientifique est mince et qu’en tant que récit, il invite à se projeter dans un futur, faisant de notre présent un passé que nous pouvons juger.
RL : Une des caractéristiques du catastrophisme est d’avancer qu’il faut avoir le futur en mémoire, même si celui-ci est effroyable, de manière à inventer les moyens de vivre et de survivre après la catastrophe, pour les plus optimistes.

RL : Quant à la datation de l’entrée dans l’époque Anthropocène, il y a plusieurs hypothèses. La plus commune la fait commencer par la révolution industrielle, qui marque le début de la libération massive dans l’atmosphère du carbone piégé dans le charbon (puis le pétrole). Une seconde la fait remonter à l’apparition de l’agriculture, ce qui signifierait que l’Holocène n’a jamais existé, puisqu’il commence à peu près à la même époque. Une autre hypothèse, enfin, attribuerait son origine à la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. L’arrivée des Européens sur le continent, suivie de la propagation d’épidémies et du massacre des Amérindiens ayant décimé jusqu’à 90 % de la population locale, ont profondément affecté la façon dont les Indiens maintenaient par l’usage du feu les grandes prairies du nord ouvertes au pâturage des bisons. En Amérique Centrale et du Sud, l’agriculture sur défriche ou brûlis a été abandonnée à grande échelle. À défaut d’entretien, ces espaces sont devenus des friches, puis des forêts, augmentant le nombre d’arbres comme autant de pièges à carbone. Les carottes de glace révèlent en effet une baisse non négligeable du taux de carbone de l’atmosphère à cette époque – ce qui correspond d’ailleurs au petit âge glaciaire, puisque le C02 est un gaz à effet de serre. Dès cette époque, l’action de l’homme a donc eu un impact repérable sur le climat. Cette hypothèse est très discutée, puisque beaucoup de commentateurs définissent l’Anthropocène comme une époque marquée par une modification non réversible du système Terre. Or, dans ce cas précis, bien que l’impact humain ait été repérable, le phénomène a été totalement réversible en ce qui concerne le climat. Il a suffi aux colons de déboiser pour rétablir la composition atmosphérique et le climat. L’impact le plus durable aura été celui sur la biodiversité : les échanges entre le nouveau monde et l’ancien ont permis aux espèces de voyager, d’où un brassage de plantes, d’animaux et de germes pathogènes recréant en quelque sorte la PangéeContinent unique s’étant morcelé au Trias, il y a 250 millions d’années..
Ce récit est-il le symptôme d’une nouvelle crise identitaire, en raison du repositionnement de l’homme dans la nature et de notre position paradoxale, tout à la fois de victime et de bourreau ?
CL : C’est là que réside la grande ambiguïté de l’Anthropocène. On a l’habitude de dire que le développement des sciences a remis en cause le narcissisme spontané des hommes, notamment autour de trois blessures narcissiques relatives à de grands décentrements : avec les découvertes de Copernic et de Newton, la Terre n’est plus au centre de l’univers et le système solaire n’est qu’un système parmi d’autres ; avec Darwin, l’homme n’a plus été créé à l’image de Dieu, il a co-évolué avec l’ensemble du vivant ; avec Freud, enfin, l’homme n’est plus, selon l’expression cartésienne, « le capitaine de son navire », puisque son inconscient lui échappe.
RL : Selon Dominique Lestel, il y aurait même une quatrième blessure narcissique, plaçant l’Anthropocène au cinquième rang. Celle-ci serait marquée par l’apprentissage de la langue des signes à une femelle chimpanzé, éclipsant le langage des caractéristiques proprement humaines.
CL : La dernière serait relative à la prise de conscience de notre impact négatif sur notre propre milieu et, a fortiori, de notre propre mise en péril. La profonde équivocité de l’Anthropocène réside dans le fait que, contrairement aux premières blessures narcissiques – résultant de découvertes décentrant l’homme –, celle-ci le remet au centre. L’Anthropocène relève plus de la science-fiction que de la science en ce sens que l’apport scientifique est mince et qu’en tant que récit, il invite à se projeter dans un futur, faisant de notre présent un passé que nous pouvons juger.
RL : Une des caractéristiques du catastrophisme est d’avancer qu’il faut avoir le futur en mémoire, même si celui-ci est effroyable, de manière à inventer les moyens de vivre et de survivre après la catastrophe, pour les plus optimistes.
Vers une éthique globale de la Nature
Ces mouvements « anti » s’opposent également à la tendance générale à considérer l’animal tantôt comme une machine dont on pourrait augmenter le rendement, tantôt comme un logiciel informatique que l’on pourrait programmer à dessein.
RL : L’expression « programmable » appliquée aux animaux tient à deux choses. D’une part on a voulu opérer chez les animaux – comme chez les végétaux – des modifications de génome en considérant celui-ci comme un programme informatique, avec l’idée qu’il suffirait de le décrypter pour connaître – et éventuellement modifier – le fonctionnement du vivant. On sait maintenant que cette approche n’est pas suffisante, puisqu’elle ne tient pas compte du fait que, si programme il y a, il se construit au fur et à mesure du développement, en fonction des interactions entre le génome et son environnement.
Ensuite, l’animal s’est retrouvé en première ligne de ce que l’on a appelé la naturalisation de l’esprit. Pour expliquer la conscience humaine en tant que phénomène naturel – et non plus seulement culturel –, les cognitivistes computationnistes ont effectué des recherches sur la façon dont le cerveau traite (à la manière des ordinateurs) les informations qui lui viennent des sens. Plus que de naturalisation, c’est d’une mécanisation de l’esprit dont il s’agit. Les animaux se sont trouvés pris dans ces travaux. Cette forme de mécanisation de l’esprit animal n’a pas eu que des aspects négatifs, puisqu’elle a permis de révéler des capacités cognitives importantes. On a ainsi renforcé la conviction (qui était déjà celle des éthologistes) que les animaux ont un univers mental bien plus riche que leur seule sensibilité (les souris apprennent de leurs erreurs, les dauphins sont capables d’enseigner des astuces à leurs congénères etc.). Cette découverte reste cependant contradictoire avec la façon dont l’animal est encore traité.
Tout ceci nous amène aux questions d’éthique et de responsabilité. De manière générale, comment définissez-vous la nature en tant que bien commun et comment en prendre soin, compte tenu de la diversité des éthiques environnementales et des approches culturelles ?
CL : À partir du moment où l’on ne considère pas la nature comme complètement extérieure à l’homme, on ne la saisit plus comme une substance, mais de façon relationnelle. La philosophie du care relève de l’idée que l’on peut prendre soin de quelque chose qui ne soit pas nous, sans pour autant être une extériorité radicale. Il n’y a pas une nature, elle est plurielle. À l’ONU, les représentants de diverses cultures pour qui la nature – au sens où nous l’entendons en tout cas – n’existe pas, utilisent un vocabulaire nouveau pour protéger leur conception de la nature. Ils ont appris à présenter leurs cosmovisions dans des termes compréhensibles par les Occidentaux – Pachamama est l’un d’eux. De la même façon, les Maoris ont fait reconnaître le fleuve Whanganui comme sujet de droit. Cette affirmation culturelle leur permet de réagir directement aux attaques contre les éléments de paysage en utilisant les ressources du droit occidental. Les animaux, en tant qu’êtres sensibles, commencent à avoir des droits. Les végétaux, pour l’instant, ne sont entrés dans le droit qu’en tant qu’objets, lorsque les espèces sont menacées. Techniquement, on peut donner des droits à n’importe quoi : un hôpital, une montagne, une mouche… mais il faut des répondants culturels.
RL : Les parcs nationaux américains sont considérés comme des parcs naturels. Or, pour les Amérindiens, notre nature, c’est leur culture. Il faudrait donc également les concevoir comme des parcs culturels.
CL : Dans cette pluralité des rapports à la nature, la difficulté est de trouver des moyens de traduction d’une éthique dans l’autre. À l’échelle globale, il est très compliqué de ne pas tomber dans l’impérialisme culturel en imposant le concept de nature occidental. Il faut donc trouver des formes de traduction pour parler de choses qui n’existent pas pour tous. D’une certaine façon, si des peuples arrivent à traduire assez facilement dans le langage occidental leurs propres revendications concernant ce que nous considérons comme la nature, c’est parce qu’eux-mêmes ont commencé à être pris par l’esprit cartésien et que leur culture est pour ainsi dire hybride.
RL : Ce qui est un peu vrai pour nous également. Si je parle à mes chats c’est que je suis un peu animiste…
Nous sommes pourtant confrontés à une volonté d’intervention de plus en plus contraignante sur le vivant, qui peut parfois s’avérer extrêmement dommageable pour la nature. Il a d’ailleurs été question par le passé de pratiquer le clonage de reproducteurs performants dans le but d’« améliorer » une espèce. Avec la méthode du gene drive, on peut effectuer une mutation ciblée qui se transmet à tous les descendants. On a, par exemple, songé à des mutations rendant les femelles stériles – recherche actuellement menée sur des moustiques. Il pourrait s’ensuivre des expériences grandeur nature d’éradication relativement rapide d’espèces considérées comme nuisibles.
Il y a cette idée d’Auguste Comte qui m’a toujours beaucoup angoissée, celle d’un monde uniquement composé d’espèces utiles aux hommes, toutes les autres ayant disparu. Ce serait terrible, d’autant plus que les hommes utilisent de moins en moins d’espèces. Heureusement, John Stuart Mill lui avait rétorqué que grâce aux progrès de la science, on trouverait une utilité extraordinaire à l’herbe la plus commune. Mais nous continuons à considérer le Progrès comme un contrôle toujours plus grand, conduisant à ce qu’un animal ne soit rien d’autre qu’un instrument sur lequel on pourrait intervenir pour se débarrasser de tout ce qui est « nuisible » ou « inutile ».
On assiste pourtant à une reconsidération de la condition animale et à une extension du mouvement antispéciste ou du végétarisme.
RL : Dans un pays comme la France, l’élevage s’est modernisé à partir du milieu du XXe siècle avec pour objectif de permettre aux foyers modestes d’avoir accès à la nourriture carnée. Les conditions de vies des animaux ont été prises en considération à partir des années 1970, en particulier quand on a pris conscience des contraintes imposées aux animaux dans les porcheries et les batteries de veaux et de volailles. Une première réaction a été de ne plus considérer l’animal comme de la viande sur pattes, ni un tréteau à pis, mais comme un être sensible dont nous devons respecter la sensibilité. C’est le début de l’animal welfareMouvement défendant le bien être animal., avec la création d’associations de protection des animaux prônant la reconnaissance de l’animal en tant qu’être sensible. Comme l’avait déjà argumenté Rousseau, c’est parce que les hommes sont doués de sensibilité que nous ne devons pas porter préjudice à nos semblables, non parce qu’ils sont doués de raison.
CL : Un second mouvement, aux racines anciennes, a commencé à prendre de l’ampleur depuis une quinzaine d’années, défendant l’idée selon laquelle non seulement les animaux ont droit au bien être mais aussi à la vie, seule chose qu’ils possèdent. Ce mouvement est hérité de l’anarchisme – et de sa haine de la violence et de l’exploitation –, mais aussi du féminisme, en raison de l’analogie de traitement entre les femmes et les animaux. Son expression prend la forme du végétarisme et du véganisme/végétalisme, invitant à éviter toute exploitation animale, même pour les œufs et le lait. Ce qui était une critique de la façon dont sont traités les animaux devient une critique de l’exploitation de l’animal en tant que telle. J’ajouterais l’importance du travail de dévoilement mené par les associations militantes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leur force, au-delà de la critique des méthodes d’industrialisation de l’élevage, consiste à révéler ce que l’on s’efforce de cacher.
RL : On ne dissimule pas uniquement les conditions d’élevage et d’abattage, mais surtout que la viande que l’on voit sur les étalages provient d’animaux qui furent bien vivants. Dans les circuits de distribution actuels, le consommateur ne voit plus les carcasses entières comme chez les bouchers. Nous mangeons de la chair et occultons les animaux dont elle est issue.
CL : Selon la lecture des mythes grecs que font Détienne et Vernant, le sacrifice animal et le carnivorisme relèveraient d’une volonté nette de se différencier des animaux. La philosophe Florence BurgatFlorence Burgat, L’Humanité carnivore, Seuil, Paris, 2017. a récemment remis en cause l’hypothèse selon laquelle cette différenciation serait marquée par le fait de consommer uniquement des animaux et non pas des individus de sa propre espèce. En s’appuyant sur l’étude des civilisations précolombiennes, elle a révélé la consommation massive d’êtres humains entretenus à cet effet. Selon elle, toute une partie des sociétés humaines aurait donc consommé des humains d’élevage. Alors que la sacralisation des rituels de mise à mort était considérée comme un moyen de souligner la gravité de l’action, elle suppose que le sacrifice était un moyen d’accroître le plaisir de manger de la viande.




