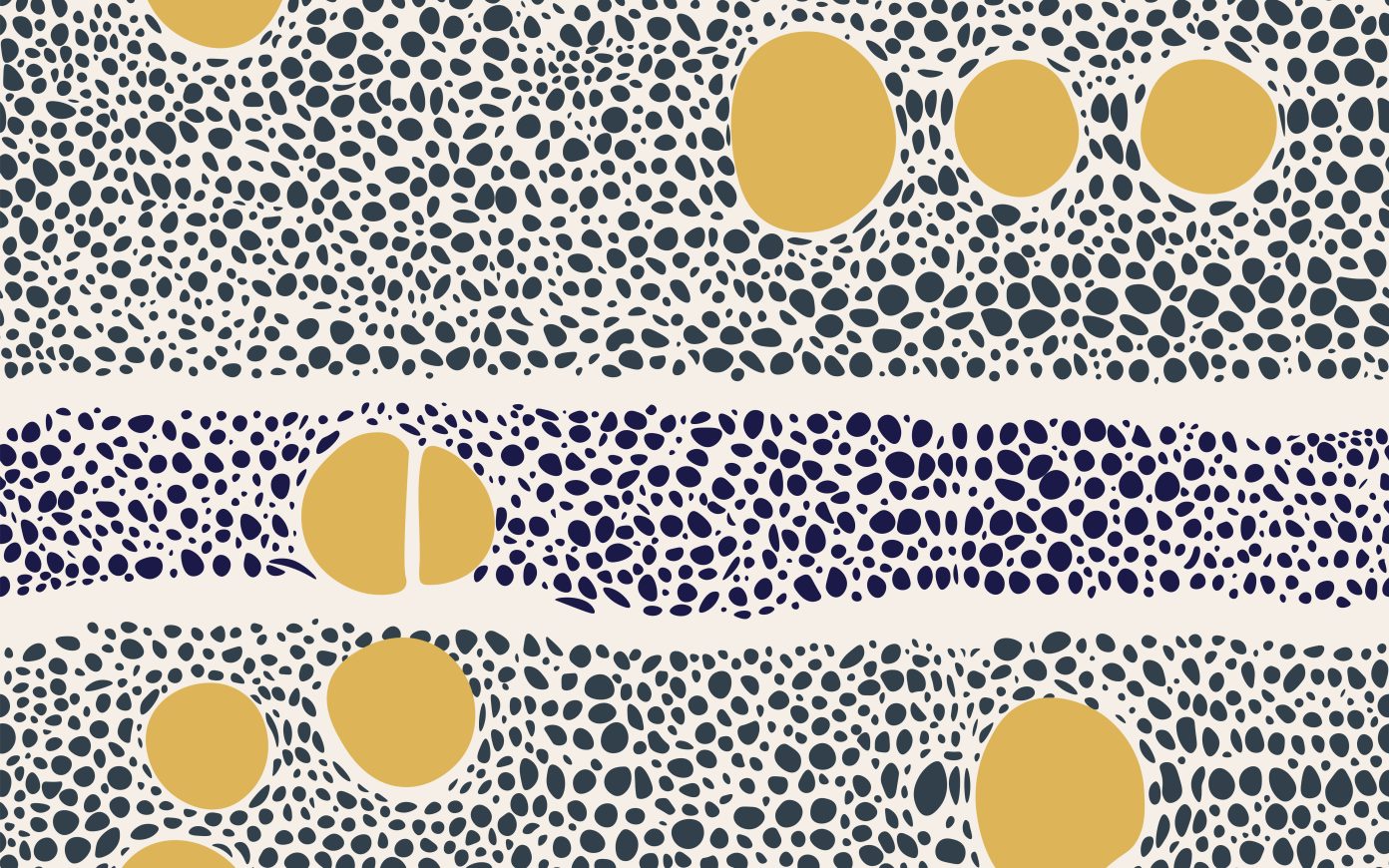Habiter le Monde

- Publié le 19 avril 2017
- Michel Lussault
L’année 1972 marque probablement un tournant dans l’histoire de l’humanité, car avec Blue Marble, photo prise par Apollo 12, cette dernière contemplait pour la première fois de l’extérieur son territoire, achevant le cycle de conquête de la terre initié par la modernité ; mais avec la parution du rapport Meadows, elle réalisait dans le même temps les conséquences néfastes de cette conquête continue. Le géographe Michel Lussault revient sur la révolution urbaine et nous expose combien elle modifie notre façon d’habiter la Terre, le Monde écrit avec un M majuscule, comme pour signifier cette nouvelle condition humaine, avant de proposer, face aux défis de la révolution urbaine, une approche de la ville en termes de spatialités plutôt que d’espaces.
Michel Lussault est géographe, professeur à l’ENS de Lyon et président du Conseil supérieur des programmes de l’Éducation nationale. Il est également président du centre d’architecture Arc-en-Rêve à Bordeaux.
Révolution urbaine
Nous vivons à l’évidence une période de mutation, et non un simple phénomène d’adaptation ou de crise, raison pour laquelle j’ai conceptualisé la notion de Monde avec un M majuscule, en insistant sur le fait que ce que nous vivons n’existait pas il y a 50 ans. Nous sommes engagés dans un processus relativement long bien sûr, séculier au sens où les processus humains sont multi-générationnels, tout ne bascule pas en cinq ou dix ans, même si aujourd’hui les innovations numériques sont plus rapides que jamais. Nous n’avions par exemple ni tablettes ni smartphones au début des années 2000, alors qu’ils bousculent désormais nos cultures et nos modes de vie.
Le mouvement général va se déployer sur un siècle, 1950-2050, avec des phases d’accélérations, et durant ce laps de temps, très bref à l’échelle de l’humanité, nous vivrons une révolution urbaine que certains n’hésitent pas à comparer en importance à la révolution néolithique ou la révolution industrielle, périodes où les modes de vie et l’ensemble des systèmes de références culturelles ont été bouleversés, subvertis, recomposés et réinventés par l’évolution propre des sociétés. Celle que nous vivons frappe par ses effets d’accélération et d’irréversibilité absolument spectaculaires.
Je ne suis pas de ceux qu’obsède l’idée que l’habitation humaine de la Terre soit plus « respectueuse » des environnements « naturels », ou qui pensent que l’on pourra effacer ou annuler la révolution urbaine, ses aspects et ses acquis.
Il y a un certain nombre de phénomènes qui sont désormais durablement inscrits dans les sociétés et les cultures : je ne vois pas comment les individus pourraient renoncer à l’individualisation, à la mobilité où à la télécommunication ; je ne vois pas comment ils pourraient renoncer à l’utilisation d’artefacts techniques, voire prothétiques, de plus en plus nombreux et puissants, ni renoncer à leur aspiration à vivre en meilleure santé. Ceux qui rêvent d’un retour à l’origine – d’une ville réinscrite dans ses bases citadines d’antan, tranquille et apaisée – font erreur, ce sont des réactionnaires, au sens strict du mot. Le véritable enjeu est plutôt d’inventer les cultures qui vont avec cette mutation, car la révolution de l’urbanisation précède la définition de ses nouveaux schémas de pensée et cadres d’intelligibilité intellectuelle, culturelle mais aussi d’action politique. Il me semble que toute activité de réflexion, de science ou de création autour de l’urbain doit partir de là.
Je parle de « révolution » urbaine pour la mettre en relation avec ces grands moments où les sociétés humaines ont installé de nouvelles manières d’habiter la Terre, comme le néolithique, dont le rapport à la production de ressources a été un bouleversement radical. L’anthropocène est d’ailleurs probablement en germe dès ce néolithique, puisqu’il y a déjà intervention dans l’écosystème. Plusieurs milliers d’années avant l’ère chrétienne, en Inde, au Moyen-Orient, un peu dans le sud de l’Europe, les sociétés humaines, dans des conditions très différentes des nôtres, avec des groupes beaucoup plus dispersés mais déjà en communication entre eux, ont installé petit à petit l’élevage et l’agriculture, sortant ainsi définitivement d’un état où les seuls moyens d’assurer sa subsistance étaient liés à la chasse, à la cueillette, à la prédation. Elles sont entrées dans un système où l’accumulation et la reproduction devenaient possible. Ce bouleversement me fait dire que c’est déjà l’anthropocène, avec la capacité de maîtrise par l’être humain de l’écosystème, que c’est déjà de la citadinité – peut-être pas de l’urbain au sens contemporain – mais déjà de la ville.
La révolution industrielle (1750-1850) imposera également une nouvelle manière d’habiter, avec l’apparition du mode de production de la ville industrielle, et aujourd’hui nous assistons à la révolution urbaine. J’essaie de montrer que l’urbain contemporain n’est pas simplement de la ville industrielle en un peu plus grosse, et qu’on ne peut plus l’aborder avec les outils conceptuels de cette époque. L’urbanisme ou l’architecture de la période industrielle n’est plus à la hauteur des enjeux, il faut trouver un langage et des pratiques qui correspondent à cette nouvelle manière d’habiter la Terre. Ce qui est curieux, c’est que cette révolution, nous l’installons, elle ne vient de rien d’autre que de nous, êtres humains sur la Terre, elle n’est pas pilotée de l’extérieur par un petit cercle d’initiés, contrairement à ce que les légendes et lectures rudimentaires veulent nous faire croire. Nous l’installons et à mesure elle nous embarque et nous dépasse, nous courons en permanence après notre propre création. Le premier réflexe est évidemment de tenter d’utiliser les corpus intellectuels, scientifiques et méthodiques dont nous avons hérités pour tenter d’arraisonner cette situation, mais nous voyons bien que cela ne fonctionne plus. C’est pour cette raison qu’il me semble que la seule notion de « ville » n’est plus suffisante pour penser l’urbain contemporain.
Spatialités
Une autre difficulté, c’est que nous avons l’habitude de penser la ville par l’espace, alors qu’il me semble qu’il faut aborder l’urbain par les spatialités, les usages. Les théories sociales et architecturales ont plutôt des approches formelles, et il y a une certaine dérive vers une systématisation du design urbain, l’idée qu’en produisant de la forme on va régler les problèmes. Je suis pour la production de formes, mais au service d’une intelligence de l’usage et de la spatialité, pas l’inverse.
Cette mutation urbaine est encore largement devant nous, mais lorsque 75% de la population mondiale seront urbanisés, nous entrerons dans une autre phase, où nous ne serons plus en situation de progression du front de l’urbanisation, mais vraisemblablement dans une période de stabilisation des configurations urbaines, ce qui posera d’autres questions. Ce qui a le plus changé aujourd’hui, c’est notre rapport aux espaces-temps, et les spatialités sont des « faire avec » les espaces et les temps.
Je ne l’aurais peut-être pas écrit comme cela il y a quinze ans, preuve que ça évolue très vite, mais la chose la plus subversive, la plus bouleversante, c’est la généralisation de ce que j’appelle l’hyper-spatialité, le principe de connexion en tous points et en tous lieux avec le développement de la télécommunication généralisée. Nous n’en sommes qu’au début, mais cette hyper-spatialité est en passe de modifier complètement nos rapports aux espaces et aux temps, à un point que nous n’avons même pas encore la possibilité d’imaginer. Nous nous trouvons dans une position extrêmement délicate où nous sommes en permanence en situation d’expérimentation, quasiment sans possibilité de consolider. À tout instant, alors que nous pensons savoir traiter par le prototype et l’expérimentation une situation, quelque chose d’autre arrive et nous renvoie un peu plus ailleurs. Pas plus loin, mais un peu plus ailleurs que ce que nous avions expérimenté. Une hyper-spatialité qui va d’ailleurs de pair avec la constitution d’un autre espace, d’un outre-espace, celui des réseaux numériques, qui chaque jour un peu plus devient un espace à part entière, et donc support de spatialités spécifiques.
Nous sommes devant quelque chose de radicalement neuf, et à mon sens nous n’avons rien de très frais en magasin pour penser cela… Certains universitaires vous expliqueront qu’il y a déjà des réponses chez les philosophes de l’antiquité grecque… Je veux bien, mais ça ne règle pas tout, et les penseurs les plus stimulants du jour sont souvent ceux qui acceptent de dire, sur les questions de télécommunications notamment : « On ne sait pas grand-chose, il faut essayer d’inventer de nouveaux outils pour arraisonner ça. »
J’essaie par exemple de ne plus utiliser la différenciation espace virtuel/espace physique, à moins d’entendre « virtuel » dans un sens très particulier. Je préfère dire que les réalités spatiales peuvent prendre un aspect ou des registres différents. Les réalités spatiales liées aux réseaux immatériels sont tout aussi réelles que les réalités spatiales matérielles. Ce brouillage ancien réel/virtuel n’est plus tenable, à tel point que dans certaines conditions nous avons l’impression qu’il y a une inversion entre l’espace matériel et l’espace du réseau, que le matériel paraît plus « virtuel » que l’espace du réseau… Il faut donc plutôt accepter que nous vivons dans un monde où, compte tenu des conditions d’habitation, nous assistons à une invention permanente d’espaces de registres différents, tous aussi réels et tangibles les uns que les autres. C’est ce qui me fait dire – et les gens ont du mal à le comprendre – que dans notre monde la quantité d’espaces croît de façon indéfinie. Contrairement à ce que l’on dit, l’espace n’est pas fini, et c’est d’ailleurs quelque chose d’assez fascinant à examiner, la manière dont les sociétés humaines créent des artefacts et des techniques pour augmenter la quantité d’espaces d’expérience possibles, dans les registres matériels ou immatériels. De ce point de vue-là nous arrivons à quelque chose qui est plus stimulant que l’opposition entre virtuel et réel, parce que finalement ce qui m’intéresse en tant qu’hyperréaliste, c’est de considérer que toute forme d’expérience nous confronte à des réalités et des expériences spatiales, concept absolument central. J’ai d’ailleurs théorisé la spatialité à partir de ma réflexion sur les notions d’expérience et d’épreuve, de situation d’épreuve spatiale.
Spatialités numériques
Les outils numériques permettent d’autres dimensions, des dimensions supplémentaires d’un même espace urbain. À l’inverse, quand nous marchons dans une rue, nous sommes évidemment dans l’espace matériel, celui que nous considérions comme le réel il y a peu de temps, mais il suffit que quelqu’un nous téléphone via Facetime ou Skype, ou tout simplement que nous surfions sur notre smartphone pour trouver une information où nous diriger, alors nous entrons dans une expérience qui mêle l’immatérialité du réseau… Il est devenu très difficile aujourd’hui de tracer des frontières nettes entre ces espaces, et cela débouche sur des questions d’une grande complexité, raison pour laquelle il faut privilégier l’approche par l’expérience et la reconnaissance des différents registres de réalité auxquels cette expérience nous confronte.
Pour appréhender cette réalité complexe, je propose une anthropologie des espaces habités, parce que cette approche permet de ne pas préempter une interprétation ou une lecture, au profit de la volonté d’observer et de rendre intelligible cette expérience spatiale composite qui nous confronte à des hybridations de réalités qui sont à proprement parler impensées aujourd’hui parce qu’impensables. Si Google arrive à commercialiser ses lunettes de réalité complétée, nous aurons un outil capable d’ajouter de l’information au réel, mais aussi d’en collecter, d’en produire, et on ne sait pas ce que cela implique. Comme toujours, nous courons après ce que nous lançons. On pourrait presque inventer un mot entre expérience et expérimentation, le verbe expériencer, illustrant le fait que nous sommes embarqués dans des actions qui nous confrontent à la nécessité de combiner des réalités de registres différents. Chaque acte est une aventure de ce point de vue, et dans ce domaine de l’expérience, nous pouvons de temps à autre avoir des moments d’expérimentation, être dans l’essai-erreur, le prototypage, dans la volonté de tester de nouvelles choses. Nous avons donc une spatialité qui est une combinaison d’expériences, de routines, de reproductions, d’expérimentations, d’inventions, d’intuitions, de sensorialités, d’interactions avec autrui plus ou moins médiées par les langages… La notion d’expérience englobe tout cela, c’est la spatialité, le faire-avec-l’espace dans toutes ses dimensions et dans tous ses registres, en interaction avec d’autres, et à l’intérieur de cette expérience on trouve des choses qui peuvent renvoyer à l’expérimentation sciemment pensée comme telle. Nous sommes face à des situations d’une nouveauté absolument radicale, essentielle, et il nous faut absolument le considérer comme une sorte de front pionnier de la recherche sur la spatialité urbaine.
Pour organiser pratiquement cette recherche, j’ai beaucoup réfléchi sur les lieux de passage, c’est-à-dire les seuils, les sas, les franchissements, ce que j’appelle la trans-spatialité, les attentes. Aujourd’hui je travaille davantage sur l’hybridation des registres de spatialité, sur les spatialités numériques en quelque sorte, en particulier sur la façon dont les nouveaux instruments ( réseaux sociaux, applications web ) constituent des moyens de produire, collecter, rassembler, diffuser de la donnée, de l’information spatiale, dans le cours de l’acte spatial, à son service et dans la volonté de le partager avec d’autres acteurs de la spatialité.
Le complexe
Deux choses concernant la complexité : tout d’abord, elle est inhérente à la vie humaine, et depuis toujours. Nous l’avons peut-être découvert il y a peu de temps, mais je ne suis pas sûr qu’un humain d’il y a 2000 ans était moins complexe qu’un humain d’aujourd’hui. On découvre chaque jour que le vivant est d’une complexité absolument ébouriffante, je pense qu’elle a donc toujours été là. C’est peut-être notre manière de l’appréhender qui n’a pas toujours été celle-ci, parce que nous avons été tentés de simplifier le réel. En revanche, ce qui est probablement nouveau, et là je relis Vladimir Jankélévitch, un philosophe que l’on pourrait à tort considérer comme un peu désuet parce qu’il a écrit de la philosophie morale, qui dit que finalement la complexité d’aujourd’hui est une complexité avec exposant. C’est une très belle formule car en fait, ce que nous avons à vivre ce n’est pas tellement la complexité de chaque objet, de chaque réalité, c’est plutôt le fait que l’urbanisation mettant en lien, en hyper-lien, en lien cumulatif chaque réalité avec l’ensemble de toutes les autres réalités, une sorte d’effet-système généralisé crée cette complexité avec exposant. En gros, chaque élément de complexité est toujours porté à la puissance N en raison de la systématisation des liens. C’est sans doute un effet de la mondialisation urbaine.
C’est nouveau, et ça débouche sur des questions géographiques très fortes, en particulier sur l’affirmation qu’aujourd’hui on est obligés de repenser complètement la notion de local et de localité. Miguel Torga en avait eu l’intuition quand il disait « le local, c’est le global moins les murs », mais il aurait dû dire « le local, c’est le global moins les murs plus les systèmes de liens ». Le global n’est plus simplement un englobement, une boîte qui contient, mais le système de liens qui fait que cette complexité avec exposant est la caractéristique même du monde. Et le local n’est pas que le plus petit élément scalaire qu’on peut repérer, c’est aussi quelque chose qui dès le départ est en lien avec l’ensemble des autres ordres de grandeur. C’est une caractéristique fondamentale de la spatialité et de l’habitation contemporaine. C’est un enjeu absolument considérable que d’essayer de repenser la localité dans cette perspective, le local étant une manière d’entrer dans cette complexité à exposant.
Le vivant
La notion de vivant me cause un certain embarras. Je vois bien la progression des métaphores sur la symbiose, le métabolisme (symbio-city, metaboli-city etc.), sur la cellule, l’organisme vivant… Ce n’est pas à proprement parler une nouveauté, l’hygiénisme avait déjà pensée la ville industrielle comme un corps vivant, par exemple. Et le modèle de la fonction de circulation urbaine a été décalqué par les ingénieurs de la découverte de la fonction circulatoire du sang par Harvey au xviie siècle. Ça a toujours été là, mais nous avons aussi vécu des périodes industrielles et post-industrielles qui ont donné d’abord à la métaphore de la ville-machine, ce qui n’est pas la même chose, puis à la métaphore de la ville-système ou de la ville cybernétique une certaine puissance. Faudrait-il considérer que l’urbain contemporain, cet urbain révolutionnaire dont nous parlons, serait de nouveau à repenser en terme de vivant, notamment du fait que la biologie du vivant nous en montre l’extraordinaire complexité avec exposant, au point d’en faire un modèle ? Je peux l’entendre, mais je ne suis pas complètement convaincu. Pourquoi ? Parce que l’urbain c’est du vivant, mais aussi beaucoup d’artefacts, beaucoup de non vivant au sens basique de la physique et de la biologie. Vous avez de l’inerte, de la matière non vivante, des artefacts techniques qui ne sont pas du vivant, et qui sont de plus en plus souvent des systèmes hybrides. Si la cybernétique et la science du cyborg progressent, on aura des hybrides de vivant et de matière non vivante, la seule métaphore du vivant n’est donc pas suffisante de ce point de vue-là. La caractéristique de l’urbain, c’est justement d’être plus proche du cyborg que du vivant. C’est pour ça que le livre de Thierry Hoquet sur la philosophie du cyborg m’intéresse beaucoup, ou celui de Donna Haraway, c’est-à-dire que les organisations urbaines contemporaines mettent en système la complexité cumulative et à exposant de choses qui sont déjà très complexes, parce qu’elles sont de l’ordre du vivant, et de choses qui ont un autre niveau de complexité qui ne sont pas de l’ordre du vivant, et tout cela fait système. C’est là que les métaphores strictement décalquées de la biologie ne sont pas complètement suffisantes.
Il faut aussi se méfier des idéaux des ingénieurs ou des scientifiques qui pensent qu’à partir du calcul, de la big data, on va pouvoir arraisonner l’ensemble des phénomènes complexes, ce qui est assez largement hors de portée aujourd’hui, surtout si on est à l’échelle du monde. Je milite plutôt pour reconnaître justement qu’aucun modèle ne permettra de façon satisfaisante de saisir les réalités urbaines, encore moins si l’on considère qu’elles ne sont compréhensibles qu’à partir d’un examen de l’expérience spatiale des individus. C’est tout simplement hors de portée de l’observateur, de l’analyste. Pour rendre intelligible l’urbain contemporain, la seule chose que l’on puisse faire, c’est d’être capables d’avoir, non pas un modèle, mais ce que j’appelle une méga-théorie, ce qui n’est pas la même chose. Par définition, une méga-théorie a des trous, une portée de récit cohérent, d’intelligibilité globale, mais dès que l’on commence à ouvrir un peu ou à focaliser, on s’aperçoit qu’il y a des failles. Sa fonction serait non pas de simuler de façon parfaitement pertinente un fonctionnement, mais plutôt de rendre intelligibles un certain nombre de grandes orientations et de grands principes directeurs. Il me semble qu’il faut vraiment travailler la méga-théorie, j’y travaille, je crois que ça tient la route, mais je n’ai pas la prétention de croire que cela règle tout. Et en même temps, il faut s’appliquer à l’observation de situations d’expériences spatiales à partir desquelles on va pouvoir glaner, collecter des faits que l’on va tenter de rendre compréhensibles, éventuellement par des modèles, mais des modèles qui ne seront pas forcément convergents, qui ne seront pas forcément des modèles intégrants, parce qu’on peut admettre qu’il y aura une pluralité de modèles utilisables. L’utopie étant par la suite d’essayer de faire en sorte que la méga-théorie et les modèles situationnels puissent s’assembler.